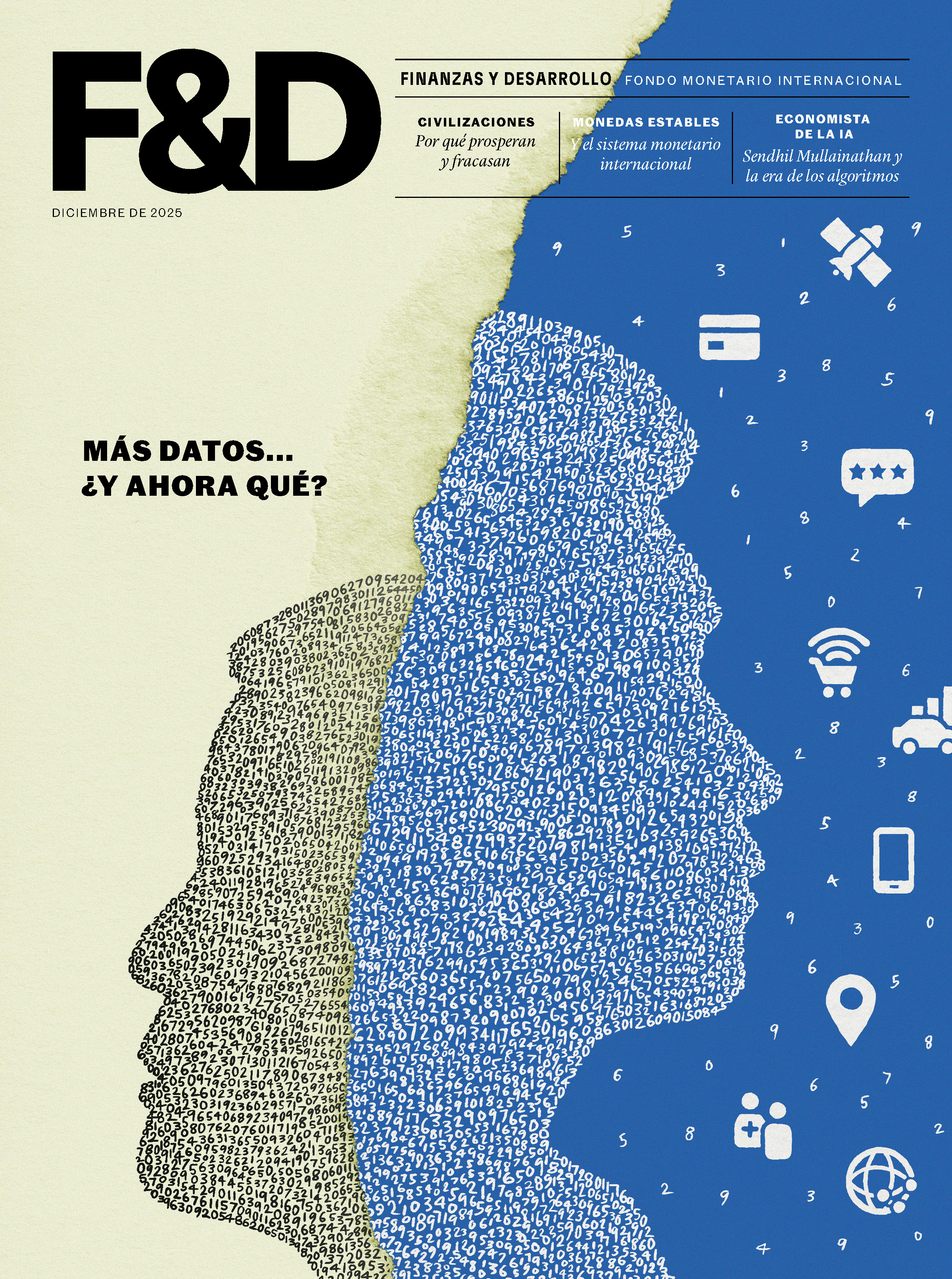Quatre-vingts ans après Bretton Woods, le FMI doit professionnaliser et dépolitiser sa prise de décision
Si le FMI n’existait pas, il faudrait l’inventer. Après avoir subi coup sur coup deux désastres qui ne se produisent qu’une fois par siècle (une pandémie et une crise financière mondiale), certains pays ont dû recourir à des emprunts massifs pour assurer la survie de leur population et de leurs institutions. Le réchauffement de la planète et l’apparition de nouveaux agents pathogènes laissent présager d’autres bouleversements. En parallèle, la multiplication des obstacles au commerce et à l’investissement entrave les dispositifs habituels destinés à lutter contre les inégalités des chances entre les pays industriels vieillissants et les pays en développement où la population est jeune. Ce fossé grandissant pousse des millions de migrants à braver les jungles inhospitalières et les océans pour tenter de s’établir dans les pays développés, un phénomène qui suscite une opposition de plus en plus forte à l’intégration mondiale.
Face à ces défis, le FMI se doit d’être une institution qui aide les pays à adopter des politiques propices à des échanges internationaux équitables des biens, des services et des capitaux, et qui accompagne l’Organisation mondiale du commerce dans sa mission en mettant en exergue les méfaits d’une approche opposée. Le FMI devrait aussi être un interlocuteur indépendant en matière de politiques nationales, en particulier celles qui menacent la stabilité macroéconomique d’un pays, et servir de prêteur en dernier ressort auprès des pays qui ne jouissent plus de la confiance des marchés. Malheureusement, même si le FMI existe bel et bien, sa structure anachronique ne lui permet pas de remplir toutes ces fonctions.
Légitimité
Le FMI a besoin de légitimité pour être en mesure de répondre aux besoins de ses pays membres. Au moment de la création de l’institution, les États-Unis étaient la seule grande puissance économique, ce qui leur permettait de rester largement au-dessus de la mêlée et de jouer un rôle fiable, et en grande partie impartial, dans l’application des règles commerciales. Les autres pays ne contestaient ni leur pouvoir de veto sur les grandes décisions ni le contrôle qu’ils exerçaient, avec leurs alliés, le Canada et les pays d’Europe occidentale, sur les nominations aux postes de direction et sur les décisions opérationnelles. Personne n’avait véritablement remis en question cette alliance de l’Ouest jusqu’à une période récente. À l’apogée de la guerre froide, l’Union soviétique (et ses pays satellites), bien que grande puissance militaire, ne pesait pas lourd sur le plan économique et se tenait largement à l’écart du système commercial mondial. Le Japon, à son apogée économique à la fin des années 80, était trop dépendant des États-Unis pour contester leur hégémonie. Le Japon est d’ailleurs aujourd’hui un membre à part entière de l’alliance occidentale. Cette domination de l’Occident n’a été remise en cause que récemment par la montée en puissance de la Chine, qui se hisse au rang de superpuissance économique et militaire.
Les griefs relatifs à la sous-représentation des pays n’appartenant pas à l’alliance occidentale se multiplient depuis un certain temps déjà. Les quotes-parts au FMI des pays membres correspondent à leurs droits de vote et au montant de leur contribution financière à l’institution. En outre, le montant maximal qu’un pays peut emprunter au FMI dans diverses circonstances est proportionnel à sa quote-part. La quote-part du Japon (6,47 %) dépasse celle de la Chine (6,40 %), bien que le poids de l’économie chinoise soit désormais plus de quatre fois plus important. La quote-part de l’Inde est inférieure à celles du Royaume-Uni et de la France, bien que l’Inde ait aujourd’hui doublé ces deux pays sur le plan économique. La logique d’une telle sous-représentation est difficile à comprendre, si ce n’est par le souci de l’alliance occidentale de s’accrocher au pouvoir.
Arguments en faveur d’une redistribution
Le FMI doit être considéré comme une institution légitime et de bonne gouvernance, non seulement pour faciliter la négociation des règles et les faire appliquer de manière impartiale, mais aussi pour être en mesure de décider de la bonne allocation de ses ressources. L’alliance occidentale n’est plus adaptée à ses objectifs, et ce pour plusieurs raisons.
Malheureusement, en raison de la crainte des États-Unis de se voir supplantés sur le plan économique et, à terme, militaire, et de la réduction de leur marge de manœuvre budgétaire, l’isolationnisme a pris le dessus au niveau de la politique intérieure. Les États-Unis ont progressivement délaissé leur rôle d’arbitre, motivé le plus souvent par le principe que l’ouverture profite à tous, pour devenir un acteur soucieux d’une ouverture à sa mesure. Le pays veut néanmoins conserver son rôle d’arbitre au sein d’organisations telles que le FMI. Sur le plan politique, il est également très difficile pour un gouvernement américain ou européen de renoncer aux pouvoirs dont il dispose, même si le maintien de ces pouvoirs affaiblit le FMI.
Face aux restrictions budgétaires observées à l’échelle mondiale, le FMI se trouve de plus en plus souvent dans l’obligation de prêter à des pays en difficulté, sans aide supplémentaire de la part de l’alliance occidentale. Les pertes potentielles liées aux prêts du FMI ne figurent pas dans les comptes publics à court terme, et l’alliance occidentale ne supporte qu’une fraction des pertes éventuelles (proportionnellement à sa quote-part) ; il est donc tentant pour elle d’utiliser les ressources du FMI pour aider des pays amis ou voisins en difficulté, même si le prêt n’est pas économiquement viable. Bien que les crédits du FMI aient toujours eu une dimension politique, l’institution a pu plus facilement mettre en place un programme de sauvetage efficace et recouvrer ses prêts grâce à l’aide extérieure de l’alliance occidentale. Les États-Unis ont, par exemple, apporté une part importante dans le plan de sauvetage du Mexique lancé en 1994. Le FMI sera sans doute amené à faire plus souvent cavalier seul, car l’alliance occidentale exerce un contrôle alors que sa part en contribution est bien moindre.
Loading component...
Enfin, l’alliance elle-même s’effrite. Le gouvernement de Donald Trump affichait de profondes divergences sur le plan commercial avec le Canada et l’Europe occidentale. Il n’est pas exclu que les changements de couleur politique dans les différents gouvernements affaiblissent le consensus au sein de l’alliance en matière d’orientation économique. Si l’alliance maintient son contrôle sur le FMI, le processus décisionnel risque d’être imprévisible.
Quotes-parts et contrôle
Si l’alliance occidentale n’est pas en mesure de garantir la bonne gouvernance, un redéploiement des quotes-parts du FMI en fonction du poids économique de chaque pays devient encore plus pertinent. Mais celui-ci peut aussi entraîner des conséquences imprévues. Sur fond de fragmentation géopolitique du monde, une hypothétique alliance centrée sur la Chine pourrait-elle, par exemple, bloquer des prêts en faveur de pays étroitement liés à l’alliance occidentale ou vice-versa ? Un mode dysfonctionnel de gouvernance ne vaut-il pas mieux que la paralysie totale ?
Peut-être, et c’est pourquoi une réforme des quotes-parts devrait être assortie d’une modification de la gouvernance du FMI : le conseil d’administration ne devrait plus voter pour chaque décision opérationnelle, notamment pour chaque programme de prêt. Ce serait plutôt à des dirigeants professionnels et indépendants de prendre ces décisions opérationnelles, dans l’intérêt de l’économie mondiale. Les administrateurs devraient définir des objectifs généraux et vérifier périodiquement s’ils sont atteints, éventuellement avec l’aide du bureau indépendant d’évaluation. En d’autres termes, les administrateurs devraient se consacrer à la gouvernance, à l’instar des membres de conseils d’administration d’entreprises, définir les mandats opérationnels, nommer et modifier les dirigeants, et contrôler la performance globale. Les décisions courantes seraient du ressort de la direction.
En résumé, pour éviter la paralysie, il faudrait professionnaliser et dépolitiser la prise de décision. Lors de la création du FMI, John Maynard Keynes, qui redoutait une influence démesurée des États-Unis, souhaitait que le conseil d’administration soit non-résident. Au lendemain de la guerre, lorsque les communications longue distance coûtaient cher et que les voyages, essentiellement en bateau à vapeur, prenaient du temps, cela signifiait avoir un conseil d’administration non exécutif et une direction dotée de pouvoirs étendus. La proposition de Keynes avait été écartée par Harry Dexter White, le négociateur américain à Bretton Woods. Il est temps de reconsidérer l’idée de Keynes, mais étant donné le progrès des communications et des transports, il faudrait exiger de façon explicite que le conseil d’administration non résident ne prenne absolument pas de décision opérationnelle.
Le conseil d’administration sélectionnerait les hauts responsables du FMI en se fondant sur les candidatures réunissant le plus large consensus, plutôt que de conférer à certains pays ou à certaines régions le droit de nomination. La dimension politique de cette procédure est inévitable, mais si le conseil d’administration établit un certain nombre de qualifications fondamentales, le jeu politique permettra de dégager un consensus autour des candidats et de s’assurer de leur efficacité.
Le nouveau et l’ancien
Une réforme radicale du FMI se heurtera à des obstacles politiques considérables, notamment la réticence des pays membres dominants à céder le pouvoir s’ils considèrent que cela risque d’être interprété sur le plan national comme un signe de faiblesse politique. Il est bien plus facile pour les pays membres de procéder par étapes, comme la récente révision des quotes-parts, et de se convaincre qu’il s’agit là d’une avancée. Les décisions difficiles peuvent être renvoyées au prochain gouvernement et inévitablement reportées. Dans cette perspective, l’organisation continuera d’exister, mais elle sera moins légitime et moins pertinente par rapport aux besoins du monde. Le FMI restera utile aux pays en développement, mais il aura beaucoup moins d’influence lorsqu’il s’agira de contribuer à l’adaptation de l’économie mondiale.
Si les quotes-parts étaient redéployées pour refléter le poids économique, sans autre changement dans la gouvernance, la Chine pourrait se retrouver avec la plus grande quote-part. Dans ce cas, conformément aux Statuts du FMI, le siège de l’institution devrait être transféré à Beijing. La politisation redoutée par Keynes se poursuivrait, mais probablement avec un nouvel ensemble d’acteurs et de règles politiques, et un nouveau groupe de pays insatisfaits et désengagés.
En revanche, si les pays membres procédaient à une réforme simultanée des quotes-parts et de la gouvernance, un FMI indépendant pourrait rapprocher les parties d’un monde fragmenté sur des sujets essentiels. Ces réformes en profondeur devraient intervenir rapidement pour être acceptées par les autres pays, faute de quoi ces derniers pourraient croire qu’il s’agit d’une tentative de l’alliance occidentale de conserver de l’influence au moment même où le pouvoir change enfin de mains.
Un FMI réformé pourrait contribuer à définir de nouvelles règles concernant les échanges internationaux, par exemple en établissant une liste préliminaire de points à négocier et en tenant compte de l’évolution de l’économie mondiale. Face à la complexité des enjeux, il pourrait réunir un petit groupe de pays pour mener les premières négociations dans le cadre de ses consultations multilatérales. Si le FMI obtenait un niveau de confiance suffisant, il pourrait définir ces nouvelles règles et veiller à leur application. Il pourrait aussi affiner ses analyses et offrir de meilleurs conseils aux pays en matière de viabilité macroéconomique et extérieure, et accorder plus efficacement des prêts à des fins de redressement.
Quatre-vingts ans après Bretton Woods, le monde doit décider s’il faut procéder à une réforme du FMI pour améliorer la collaboration avec les pays membres et surmonter les difficultés qu’ils rencontrent, ou s’il ne faut rien faire et laisser le FMI s’étioler.
Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.