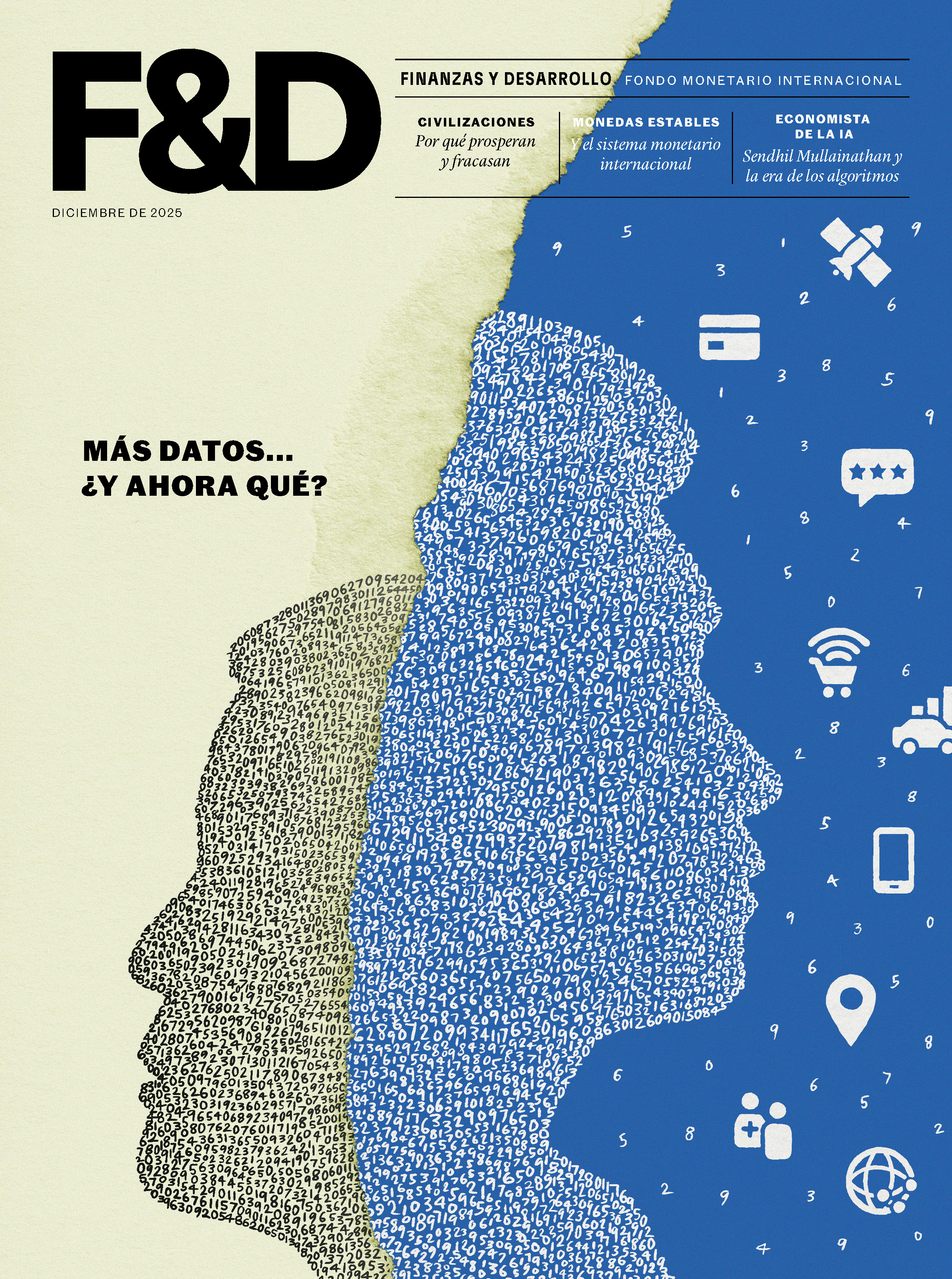Le capitalisme décrit par Adam Smith exige d’imposer des contraintes aux marchés et non de leur accorder une confiance aveugle
La prose aride d’Adam Smith profite généralement du recours à une métaphore évocatrice. Cela dit, nous serions tous en meilleure posture, n’eût été la mention de « la main invisible » par l’économiste universitaire. Il avait sans doute accordé peu de sens, voire aucun, à l’expression qu’il n’utilise qu’une seule fois dans l’intégralité des deux volumes de la Richesse des nations, comme dans un autre ouvrage, Théorie des sentiments moraux, dans un tout autre contexte.
Et pourtant, durant la seconde moitié du 20e siècle, ce concept a nourri l’élaboration de toute une vision du monde par les économistes. Cette dernière a donné lieu à une hypothèse sans fondement, à savoir que, selon les termes de Pat Toomey, ancien sénateur américain, le « capitalisme n’est rien d’autre que la liberté économique » qui, sans intervention, porte tout simplement ses fruits. À l’instar du personnage de dessin animé Vile Coyote, les économistes ont avancé bille en tête munis de plans dépourvus de toute forme de soutien. À ceci près que ce ne sont pas les économistes qui sont tombés au fond du ravin, lorsque leur absurdité a été révélée au grand jour, mais bien les citoyens ordinaires.
Pour comprendre cette expression, nous devons en prendre connaissance dans son milieu naturel : « En préférant le succès de l’industrie nationale à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande sûreté », écrit Smith, et de poursuivre, « et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ». La main invisible ne faisait pas référence à une force magique, mais à une préférence pour l’industrie nationale et la détermination à diriger cette industrie de telle sorte qu’elle produise la plus grande valeur.
C’est donc ainsi que, durant la plus grande partie de son histoire, la main invisible a justement reçu le peu d’attention qu’elle méritait. En revanche, une simple recherche de l’expression « led by an invisible hand » (conduit par une main invisible) dans Google Ngram permet d’obtenir un tracé de la fréquence d’apparition de l’expression dans tous les livres de langue anglaise depuis 1800 et révèle que, juste après la Seconde Guerre mondiale, l’usage de l’expression a commencé à se répandre de façon inexorable. Déterminés à défendre le capitalisme démocratique de l’engouement que suscitait le communisme centralement planifié, des économistes tels que Paul Samuelson et Friedrich Hayek ont alors adopté la métaphore d’Adam Smith et lui ont accordé une importance centrale au sein de la logique du libre marché.
Confiance aveugle
Jonathan Schlefer, rédacteur en chef de longue date de la revue Technology Review du Massachusetts Institute of Technology, a démontré la façon dont L’Économique de Samuelson — dont la première publication est parue en 1948 et qui a constitué, durant des décennies, le manuel phare de cette discipline — a déformé cette modeste idée pour en faire une déclaration de confiance aveugle et l’a placée au cœur de la vision du monde de l’économiste. Voici la citation de Smith enseignée aux étudiants : « Il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions. » La phrase ne comporte même pas de points de suspension.
Hayek a élevé l’expression au rang de religion, professant sa « foi » dans les « forces d’ajustement spontanées ». Il était fier de « présumer que, surtout dans le domaine économique, les forces autocorrectrices du marché amèneront les adaptations requises par les situations nouvelles, même si personne ne peut prédire comment elles le feront dans chaque cas ». À partir des années 90, l’historienne économique Amity Shlaes écrivait, dans le New York Times, qu’Adam Smith avait créé une « image puissante » de la « main invisible », la main du libre commerce qui produit un ordre magique et est source d’harmonie dans nos vies ». Ce qui, au départ, décrivait les conditions selon lesquelles les marchés peuvent promouvoir l’intérêt commun est devenu une affirmation selon laquelle les marchés feraient cette promotion de manière miraculeuse et automatique dans quelque condition que ce soit.
En revanche, si l’on fait abstraction des conditions énoncées par Smith, alors la logique s’effondre en théorie, tout comme cela a été observé en pratique. Si le dur labeur — à forte intensité de capital et de main-d’œuvre — d’extraction des ressources naturelles, de la pratique de l’agriculture, de la construction d’infrastructures, et de la fabrication de produits offre le meilleur rendement du capital, les hommes d’affaires qui ne pensent qu’à leur intérêt personnel travailleront de fait pour l’intérêt général. Si de telles activités offrent systématiquement un profil d’investissement moins attrayant que de tenter de créer une application en nuage dont la valeur dépasserait le milliard de dollars, dont la portée pourrait s’étendre à des millions d’utilisateurs en l’espace d’un an ou deux et ne nécessiterait que quelques employés, le capitalisme pourrait engendrer une copie conforme de la croissance du PIB, mais il ne portera pas ses fruits selon le sens initial entendu par Smith et de manière à répondre aux besoins d’une nation.
Loading component...
Si la croissance et l’accroissement des marges bénéficiaires reposent sur l’investissement dans une productivité accrue des travailleurs, il en résultera de l’innovation, les salaires augmenteront et la prospérité se répandra. En revanche, si les entreprises parviennent à accroître leur chiffre d’affaires et à réduire les coûts plus facilement en délocalisant la production vers une main-d’œuvre étrangère, ou en ramenant cette main-d’œuvre aux États-Unis pour créer des « emplois dont les Américains ne veulent pas », le capitalisme ne fonctionnera pas. Si les meilleurs talents commerciaux constatent qu’ils peuvent s’enrichir davantage dans un va-et-vient d’échanges de grandes quantités d’actifs plutôt qu’en faisant des placements rentables dans l’économie réelle, le capitalisme ne fonctionnera pas. Comme l’ont appris les États-Unis, le marché engendrera des bénéfices, mais également un déclin national.
Tentez d’obtenir des économistes qu’ils vous expliquent leur confiance dans le capitalisme comme moteur de prospérité dans un contexte de mondialisation, et leurs explications tombent tout doucement à l’eau. Il est entendu que le capitalisme peut fonctionner, mais uniquement au moyen de contraintes qui garantissent le caractère réellement et mutuellement enrichissant de la configuration des échanges qui en découleront. Quel avantage y a-t-il pour un travailleur de l’Ohio lorsqu’un investisseur local déplace des capitaux vers Shenzhen en quête de meilleurs rendements ? Hayek avait promis qu’un certain « équilibre indispensable entre offre et demande, exportations et importations, ou autres paramètres analogues, se produirait sans intervention délibérée ». Le déficit commercial des États-Unis, de l’ordre de mille milliards de dollars, donne à penser autrement.
Le raisonnement par l’absurde relatif à la main invisible imaginaire est incarné par la confiance qui émane de Wall Street selon laquelle la propagation de la financiarisation de l’économie doit être avantageuse pour la nation, car elle reflète le choix des personnes en quête de profit. À titre d’exemple, Todd Henderson et Steven Kaplan, professeurs à l’Université de Chicago, ont soutenu, dans le Wall Street Journal, que les placements dans le capital-investissement génèrent une « valeur sociale considérable » en se fondant uniquement sur le fait qu’ils produisent des rendements bruts supérieurs aux moyennes du marché. Cela dit, de fait, il n’existe aucune théorie ou preuve dans le domaine économique qui accrédite l’idée selon laquelle les stratégies qui engendrent les rendements les plus élevés sur les fonds d’acquisition par emprunt ont un quelconque lien avec les types d’investissement qui, au mieux, selon Smith, permettent de « promouvoir l’intérêt public ».
Fondamentalisme de marché
Contrairement au fondamentalisme de marché, soutenu par une mauvaise compréhension du concept de « main invisible », la pensée première d’Adam Smith offre aux décideurs contemporains des orientations très utiles. Comment pouvons-nous favoriser une préférence pour le « succès de l’industrie nationale à celui de l’industrie étrangère » et veiller à ce que, en « dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible », cela ouvre la voie vers le plus grand profit ? Ces conditions, de concert avec la « liberté », sont le préalable à un système capitaliste fonctionnel.
Fait encourageant, la popularité croissante du concept de la main invisible dans Google Ngram s’est interrompue brusquement en 2014–15, pour entamer ensuite une chute tout aussi abrupte. Il se trouve que cette période coïncide avec la publication par David Autor et ses collègues de leur recherche sur le « choc chinois » (China Shock) et le moment où Anne Case et Angus Deaton ont attiré l’attention sur l’augmentation désastreuse des « morts de désespoir ». L’année suivante, le Royaume-Uni a voté le retrait de l’Union européenne et les États-Unis ont élu Donald Trump à la présidence. Comme si, par le fait d’une main invisible, nos systèmes politiques réagissaient aux échecs et créaient des possibilités de rectifier le tir.
Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.