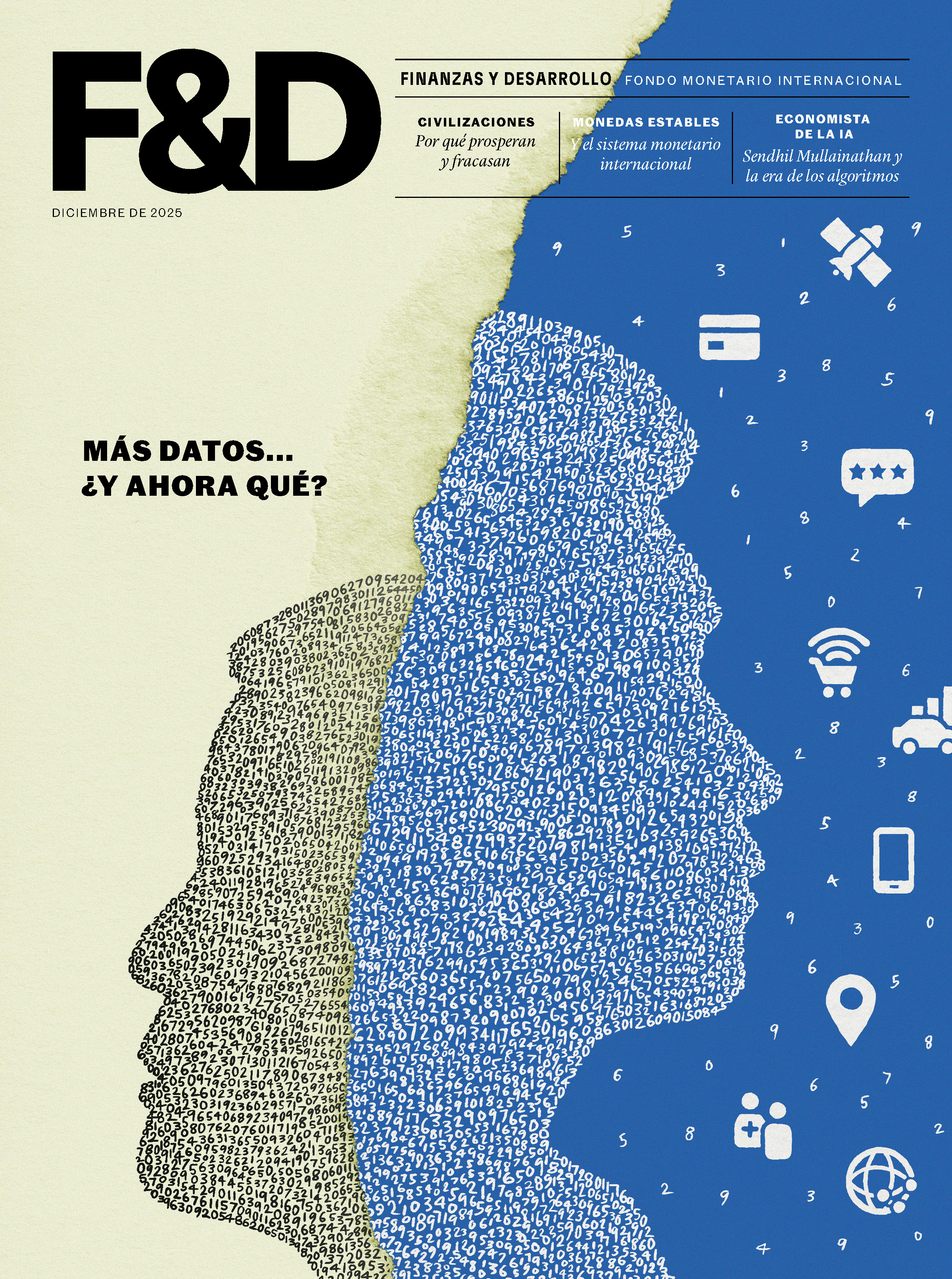En Türkiye, au Kenya, en Colombie et au Bangladesh, des économistes changent la donne
Dans les pays en développement, la recherche empirique a beaucoup à offrir lorsqu’il s’agit d’éclairer les politiques intérieures et extérieures, mais elle fait rarement parler d’elle. Plus de 90 % des articles publiés dans les 10 principales revues économiques proviennent d’institutions occidentales, et la plupart d’entre eux sont rédigés par des hommes. Si les femmes sont sous-représentées dans le domaine de l’économie en général, les femmes économistes sont encore plus rares dans les pays en développement.
La collaboration du FMI avec l’initiative « Women in Leadership in Economics » de l’International Economic Association (IEA-WE) met en lumière les femmes économistes à l’origine d’études locales cruciales qui éclairent les décideurs dans des domaines souvent perdus de vue.

Ipek Ilkkaracan : Le dividende mauve
C’était une fin d’après-midi, en 2009, elle ne se souvient plus précisément quand, mais elle se trouvait dans une salle de conférence à Istanbul, sa ville natale, au milieu d’une foule d’économistes internationaux fatigués par leur voyage et pressés d’aller au bar après toute une journée à écouter des exposés sur l’économie verte, le sien étant le dernier de la liste. Mais lorsqu’elle s’est dirigée vers l’estrade, elle les a vus se disperser lentement, ayant entendu tout ce qu’ils voulaient entendre. Prête à tout pour les faire revenir, elle a eu tout à coup une illumination. Elle s’est penchée pour parler dans le micro et a déclaré : « Pour assurer un ordre économique véritablement durable, l’économie verte ne suffit pas. Il faut une économie mauve. » L’auditoire a dressé l’oreille, les commandes au barman se sont interrompues, le terme « économie mauve » était né.
L’idée d’Ipek Ilkkaracan d’utiliser la couleur mauve lui est venue parce qu’elle est associée au mouvement turc en faveur des femmes, mais elle a appris peu après qu’elle était le symbole de mouvements féministes dans plusieurs autres pays. Et tandis que l’économie verte vise à plus de durabilité en agissant sur les politiques environnementales, l’économie mauve d’Ilkkaracan symbolise désormais la lutte pour une économie plus durable grâce au renforcement de l’égalité accrue entre les genres et de l’investissement dans les infrastructures de protection sociale.
Ilkkaracan enseigne l’économie à la faculté de gestion de l’université technique d’Istanbul, et ses travaux portent surtout sur le travail, le développement et l’économie féministe. « Pendant mes études supérieures, je me suis toujours considérée comme une féministe. Mais mon engagement pour l’économie féministe s’est renforcé quand je suis devenue mère et que j’ai commencé à prodiguer des soins à un rythme intensif sans être rémunérée tout en essayant d’avancer dans ma carrière. »
Se sentant trahie par sa propre discipline qui ignorait complètement ce domaine de production si vital pour le bien-être d’une société, Ilkkaracan a commencé à creuser la question des avantages économiques associés à l’activité des aidants. Ses travaux ont rapidement obtenu la reconnaissance d’ONU-Femmes, de l’Organisation internationale du Travail et de gouvernements du monde entier soucieux d’améliorer les perspectives d’emploi et la croissance ; Ilkkaracan explique en effet que ces services d’aidants représentent un potentiel de création d’emplois supérieur à celui de tout autre secteur.
« Dans le contexte turc, nous avons comparé le potentiel de création d’emplois des dépenses publiques selon qu’elles servent au secteur des services de soins (accueil des jeunes enfants, par exemple) ou à celui de la construction. Et nous constatons que les dépenses engagées pour les services de la petite enfance et la préscolarisation peuvent créer trois fois plus d’emplois que des dépenses équivalentes consacrées au secteur de la construction. »
S’agissant des pertes d’emploi potentielles dues à la technologie, Ilkkaracan assure que, là encore, l’économie mauve peut y apporter une réponse.
« Chaque jour, le travail non rémunéré effectué dans le monde, au sein des foyers, sous la forme d’activités de soins, est une production des ménages qui se chiffre à 16,5 milliards d’heures. Si nous en convertissions ne serait-ce que la moitié en travail rémunéré, cela représenterait des centaines de millions d’emplois nouveaux. Alors, quand un collègue masculin demande : “D’où viendront les futurs emplois ?”, j’ai juste envie de rire parce que, pour moi, la réponse est évidente.
Loading component...

Rose Ngugi : Les données comme levier
La vie est une suite d’événements. Parfois les plus petites choses, celles qui semblent parfaitement anodines, produisent des effets durables. « À l’époque, l’économie n’était pas enseignée dans les écoles ; puis quelqu’un est arrivé pour nous parler de certains sujets nouveaux. Je n’y connaissais strictement rien, mais je me suis dit : “OK, allons découvrir ce qu’est cette chose que l’on appelle économie”. »
Rose Ngugi a quitté son lycée kényan avec l’envie d’en apprendre davantage parce que « quand vous voyez des gens acheter et vendre sur un marché, vous vous dites peut-être “ce n’est rien d’autre que ça”, mais vous vous apercevez ensuite qu’il s’agit d’un écosystème dans lequel nous évoluons tous. Alors, en comprenant ses tenants et ses aboutissants, il est plus facile de voir à quels niveaux intervenir pour améliorer la société. »
Celle qui détient aujourd’hui un doctorat est partie à l’époque étudier l’économie à l’Université de Nairobi et celle de Birmingham, au Royaume-Uni. Elle a aussi travaillé six ans au FMI avant de retourner au Kenya pour aider le gouvernement à appliquer son programme de développement dans le cadre du processus de décentralisation, qui confère plus d’autonomie aux comtés du pays. En tant qu’administratrice de l’Institut de recherche et d’analyse des politiques économiques du Kenya (KIPPRA), Ngugi, avec son équipe, fournit des données sectorielles aux comtés, sous forme d’indices servant à évaluer l’incidence et l’efficacité des politiques qu’ils appliquent.
« Les indices sont magiques, indique Ngugi. Ils aident les comtés à se focaliser sur les domaines où, manifestement, les résultats ne sont pas très bons. » Les données de qualité sont une denrée rare dans bien des régions africaines, mais ce qui rend les indices de Ngugi encore plus précieux est leur adaptation au contexte kényan : ils mesurent des activités réelles importantes pour les collectivités locales, par exemple le secteur informel, qui représente 80 % de l’emploi.
« Quant à la croissance dans ce pays, il n’est pas possible d’obtenir des résultats sans savoir où se trouvent les principales sources de croissance, explique-t-elle. Nous avons beaucoup de jeunes qui créent ces micro et petites entreprises informelles. Alors, vous vous demandez si elles sont assez productives. Si elles créent des emplois décents. Il faut considérer les micro et petites entreprises comme le socle de base et l’étayer, ce qui n’est possible qu’en allant dans les comtés, en comprenant l’environnement dans lequel ils évoluent. Vous pouvez ainsi axer vos politiques directement sur les enjeux locaux, sur leurs aspects très concrets à l’échelle des comtés. »
D’après Ngugi, les indices aident 47 comtés du pays à construire des économies locales plus fortes, en phase avec l’approche ascendante que préconise le gouvernement national pour la transformation économique du Kenya.
Loading component...

Marcela Eslava : Repenser la protection sociale
« Je pense que l’environnement où vous avez grandi vous donne à coup sûr une vision des choses que les autres n’ont pas forcément. Ma vie quotidienne est une source de questionnements du fait des problèmes que je vois tout autour de moi. »
Eslava a été douée très tôt pour les mathématiques, mais était davantage intéressée par les problématiques sociales, qui étaient extrêmement nombreuses à Bogota, où elle était scolarisée. La diversité de son pays lui semblait tout bonnement incroyable.
« Je ne parle pas de la diversité positive, mais de la mauvaise diversité, celle des inégalités, qui ne s’explique pas par les simples différences entre les gens, mais par l’inégalité des chances. Et je pense que faire partie intégrante de cette réalité vous amène naturellement à réfléchir aux interactions entre la société, l’économie, la politique et les politiques. Ce fut mon cas. »
Pour Marcela Eslava, l’économie cochait donc toutes les cases. Elle a poursuivi ses études à l’Université Los Andes à Bogota, où elle enseigne aujourd’hui, et elle est titulaire d’un doctorat de l’Université du Maryland. Les inégalités sociales qu’elle avait observées pendant son enfance colombienne avaient été son premier sujet d’intérêt ; à présent, Eslava est à la tête de l’Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (ADEALC), qui facilite les échanges d’idées entre économistes et décideurs dans toute la région.
Les travaux d’Eslava l’ont amenée sur de nombreux chemins, mais certains thèmes sont récurrents. Les bas revenus et le niveau élevé des inégalités constituent le socle de ce qu’elle nomme « le problème de développement de l’Amérique latine ». « J’ai vécu toute ma vie en Amérique latine et c’est notre réalité quotidienne, dit-elle. Cette réalité a des incidences importantes sur les gens qui vous entourent. Vous voyez la pauvreté. Mais aussi l’agitation et la grogne sociales. »
Dans ce contexte, les emplois informels sont en général les plus nombreux, or ils ne contribuent pas au système de sécurité sociale. Résultat, il n’y a ni retraite ni assurance maladie. Les salaires sont aussi très bas. Enslava parle à ce propos d’« entrepreneuriat de survie », un type d’entrepreneuriat concernant la moitié des travailleurs latino-américains, qui auraient sinon légalement droit à des prestations sociales.
« Nos systèmes de sécurité sociale sont très dysfonctionnels dans le sens où, même s’ils assurent théoriquement un degré de sécurité raisonnable à la population, une grande partie de cette population n’est pas couverte par les dispositions légales. »
Pour Eslava, il est temps de revoir ces systèmes afin qu’ils reflètent la réalité actuelle et protègent les individus en fonction des risques auxquels ils font face plutôt qu’en fonction de la manière dont ils gagnent leur vie.
« L’assurance maladie devrait fonctionner quand vous êtes malade, y compris si votre emploi relève du secteur informel. Mais un tel système doit être financé, et nous devons donc repenser le mode de financement de la protection sociale. Ce qui implique de reconsidérer complètement les impôts et les cotisations prélevés par l’État. »
Loading component...

Rumana Huque : La rente tabagique
Le terme d’industrie du tabac est peut-être devenu un anachronisme dans le monde occidental, comme si la bataille avait été livrée et gagnée il y a des années, en tout cas pour l’essentiel. En revanche, ce n’est pas vrai dans les pays en développement. « La consommation de tabac est vraiment importante au Bangladesh, mais pas seulement, dans toute l’Asie du Sud-Est aussi. La dernière série d’enquêtes mondiales sur le tabagisme chez les adultes, réalisée en 2017, montre que 35,3 % des personnes de 15 ans et plus consomment des produits du tabac. »
Rumana Huque n’a jamais aimé l’odeur des cigarettes que son père fumait chez eux, à Dhaka. Mais au Bangladesh, les hommes fument, et l’économie en dépend. D’après le Bureau national des recettes, l’industrie du tabac représente entre 9 et 11 % des recettes fiscales bangladaises.
« Quand j’ai entamé mon doctorat à l’Université de Leeds, j’ai commencé à travailler sur la lutte antitabac, raconte Huque. J’ai constaté les conséquences sanitaires massivement négatives du tabac, mais compris aussi le poids économique qu’il représentait et à quel point l’industrie du tabac manipulait l’élaboration des politiques à tous les niveaux. » Huque s’est spécialisée dans l’économie de la santé à l’Université de Dhaka, où elle enseigne aujourd’hui.
Les effets du tabac sur la santé ne sont pas un secret ; celui-ci tue plus de 160 000 Bangladais par an. Bien que les recettes fiscales ne soient pas négligeables, Huque a fait les comptes, et les taxes sur les produits du tabac sont loin de couvrir les coûts de la morbidité liée au tabagisme. Elle assure que la dépendance du pays aux recettes fiscales issues du tabac dresse les ministères les uns contre les autres.
« Pour le ministère de la Santé, la priorité est bien sûr d’améliorer la santé publique. Quant au Bureau national des recettes, il compte bien évidemment sur les recettes des taxes sur le tabac pour remplir les caisses. Mais il doit trouver d’autres sources de rentrées fiscales, et ne pas se contenter de ce que rapporte le tabac. Il y a un arbitrage à faire, il faut prendre la décision dans l’intérêt supérieur de la population, ce qui sera indéniablement un progrès en matière de santé publique. »
Dans un pays où tant de gens fument, les non-fumeurs courent des risques également. Huque et ses collègues ont mené une étude portant sur 1 300 enfants d’âge scolaire et constaté la présence de nicotine dans la salive de 95 % d’entre eux, signe d’un tabagisme passif. D’après d’autres études, nombre de ces enfants en viendront sans doute eux aussi à consommer des produits du tabac. C’est un cercle vicieux.
Le père de Huque a fini par souffrir d’une mauvaise toux qui l’a contraint à se rendre chez le médecin de famille. « Il a pris la chose très au sérieux et compris à quel point cela affectait sa santé et qu’il ne voulait pas que ses enfants suivent son exemple et soient fumeurs plus tard. Alors, il a arrêté de fumer et aucun d’entre nous n’a fumé par la suite. »
Huque dit qu’il est temps que le Bangladesh revoie la structure de la fiscalité sur le tabac, car les taxes sont le moyen le plus efficient de dissuader le tabagisme.
Loading component...
Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.