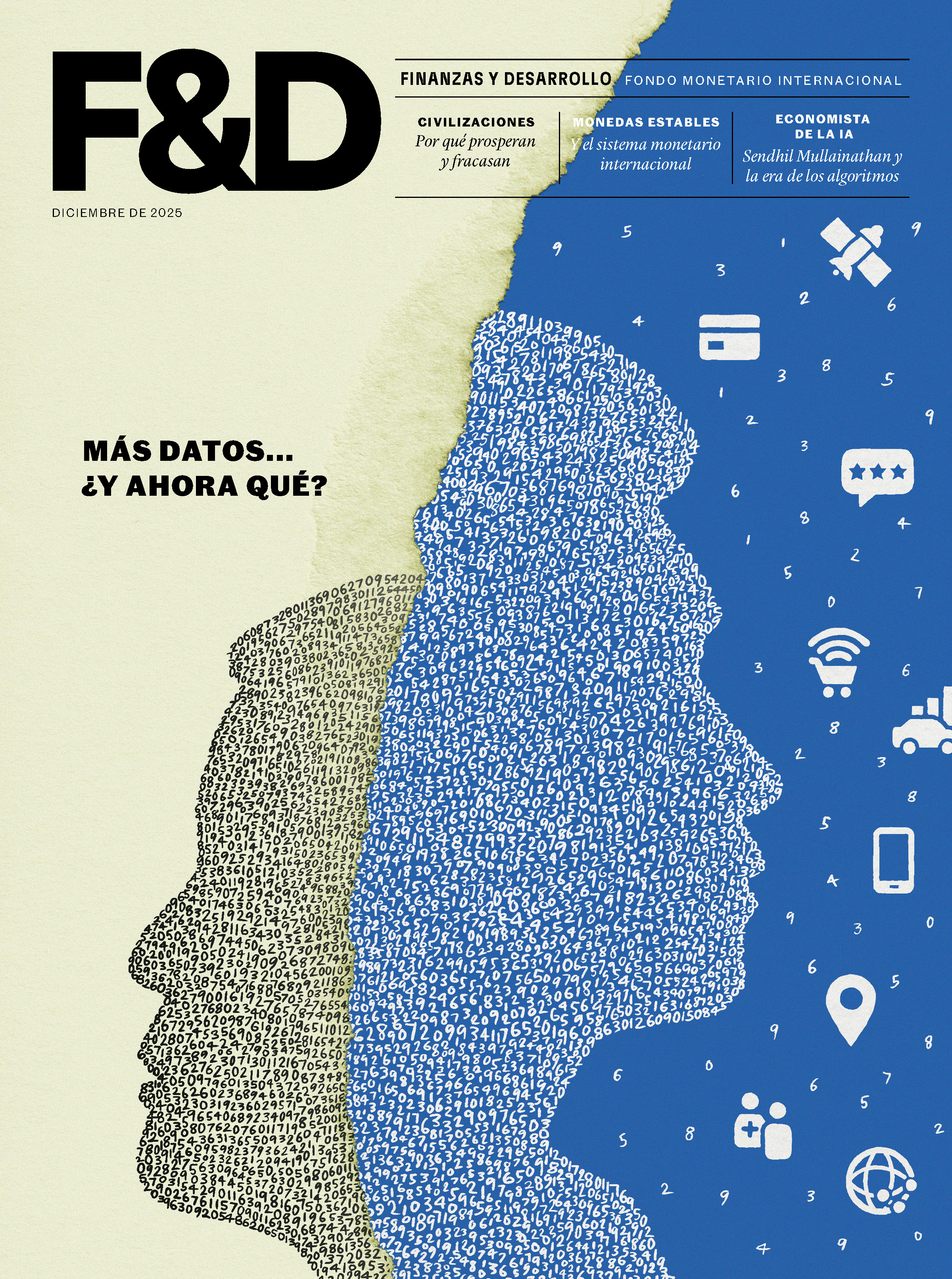Remettre la réflexion éthique au cœur de l’économie permet de mieux comprendre les résultats politiques
Pendant la majeure partie du XXe siècle, les disciplines de la psychologie morale et de l’économie ont été considérées comme distinctes — chacune se concentrait sur des préoccupations séparées, et la fertilisation croisée était rare. Or, il n’en a pas toujours été ainsi.
À l’époque de philosophes comme Adam Smith ou Karl Marx, les débats sur l’économie politique étaient profondément imbriqués avec les questions de morale. Depuis quelque temps, ces domaines se connectent de nouveau, dans une prise de conscience de l’influence profonde que la morale exerce sur le comportement économique, et vice versa. C’est un sujet que j’ai abordé il y a peu dans une revue des recherches les plus récentes dans ce domaine (2024).
En tant qu’économiste, je pense que cette intersection croissante offre des enseignements précieux non seulement pour le monde universitaire, mais aussi pour les responsables des politiques confrontés aux grands problèmes d’aujourd’hui, tels que le creusement des inégalités, la polarisation politique et l’érosion de la confiance dans les institutions.
L’une des idées les plus fondamentales à l’origine de la reconnexion de la psychologie morale avec l’économie est celle, issue de la psychologie morale, que la moralité a évolué pour devenir un outil économiquement fonctionnel, comme l’a noté, par exemple, le psychologue américain Jonathan Haidt dans The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion.
En termes simples, la moralité est considérée comme un mécanisme par lequel une société impose la coopération, permettant la production à grande échelle, l’échange et la cohésion sociale. L’idée que la morale est socialement et économiquement fonctionnelle est profondément ancrée dans une perspective évolutionniste : à mesure que les sociétés humaines se complexifiaient, la coopération est devenue essentielle à la survie, et des systèmes moraux sont apparus pour imposer des comportements prosociaux.
Impérialisme économique
Du point de vue d’un économiste, cette conception de la moralité en tant que réponse à des problèmes économiques — comme la garantie de la coopération dans les transactions — porte à croire que la moralité n’est pas figée, mais adaptable. Les contextes économiques changent et, avec eux, les valeurs morales. La mondialisation des marchés peut, par exemple, faire passer une société d’un cadre de particularisme moral — qui privilégie la coopération étroite au sein d’endogroupes très soudés — à un cadre plus universaliste qui met l’accent sur l’équité et l’égalité au sein de réseaux sociaux plus étendus.
Les économistes ont repris ces idées issues de la psychologie morale et les ont développées. Ce phénomène, que l’on qualifie souvent d’« impérialisme économique », correspond à l’utilisation par certains économistes d’outils et de méthodes dans des domaines traditionnellement analysés par d’autres sciences sociales, telles que la psychologie ou l’anthropologie. Parfois critiquée pour empiéter sur d’autres disciplines, cette démarche peut néanmoins se révéler très productive lorsqu’elle est mise en œuvre de manière collaborative.
Plutôt que d’essayer de remplacer la psychologie morale, les économistes s’attachent à éprouver et valider ses théories — comme le rôle fonctionnel du discernement moral — par un travail empirique à grande échelle. Ce faisant, ils fournissent des informations précieuses, en particulier lorsque des essais empiriques dans des configurations plus larges et réelles sont nécessaires.
Pour comprendre comment les systèmes moraux évoluent en réaction à l’évolution du contexte économique, nous pouvons nous pencher sur plusieurs exemples clés. Tout d’abord, les structures de parenté anciennes offrent une étude de cas convaincante. Les sociétés dotées de réseaux familiaux étendus s’appuient souvent sur une coopération étroite au sein des familles, ce qui conduit à des valeurs morales particularistes. Ces sociétés privilégient la loyauté envers la famille et le groupe, une orientation qui se traduit dans leur système moral.
Les sociétés dont les réseaux de parenté sont plus lâches ont toutefois tendance à développer des valeurs morales plus universalistes, l’équité s’appliquant aussi bien aux étrangers qu’aux parents éloignés, comme je l’ai expliqué dans un article de 2019. Cette distinction entre morale universaliste et morale particulariste, et son lien avec les structures de parenté historiques, explique en grande partie les variations interculturelles dans les croyances morales, les valeurs et les émotions.
Deuxièmement, l’exposition aux marchés joue également un rôle essentiel dans la formation des valeurs morales. Dans les sociétés où les interactions marchandes entre étrangers sont courantes, les valeurs universalistes, telles que l’équité dans les relations avec les personnes extérieures au cercle immédiat, sont susceptibles de prospérer. Un nombre croissant d’études, dont mon propre article de 2023, montrent que les sociétés qui sont depuis toujours davantage exposées aux marchés affichent des niveaux plus élevés d’universalisme. Plus les gens interagissent avec des étrangers sur les marchés, plus ils se dotent de normes morales qui favorisent la coopération et la confiance impersonnelles.
Enfin, l’écologie, c’est-à-dire la relation entre les sociétés et le milieu naturel dans lequel elles évoluent, peut également influencer la moralité. Là où une coopération intensive avec les voisins était nécessaire à la survie, comme dans les régions aux terres homogènes et fertiles, des valeurs particularistes se sont souvent formées. Ces valeurs mettent l’accent sur des liens communautaires étroits, essentiels à la productivité agricole.
À l’inverse, les régions où les conditions écologiques sont plus variables ou plus fragmentées ont pu favoriser des valeurs universalistes, du fait que la coopération avec les proches voisins (et l’apprentissage auprès de ceux-ci) était moins importante pour la production économique, comme l’a noté l’économiste israélien Itzchak Tzachi Raz.
Loading component...
Résultats politiques et économiques
L’influence de la moralité sur le comportement économique agit dans les deux sens : les conditions économiques modèlent les valeurs morales, mais ces valeurs, à leur tour, façonnent les résultats politiques et économiques. Dans le climat actuel de polarisation politique, les différences morales sous-tendent souvent les divisions concernant la politique économique. Par exemple, la distinction entre valeurs universalistes et valeurs particularistes permet d’expliquer pourquoi différents groupes ont des points de vue opposés sur des questions telles que la fiscalité, la redistribution, l’immigration, le dérèglement du climat, la mondialisation et l’aide internationale.
La principale conclusion est que nombre de politiques traditionnellement de gauche sont relativement universalistes par nature. Les individus universalistes, qui privilégient l’équité et l’égalité pour tous, sont plus susceptibles de soutenir les politiques de redistribution visant à réduire les inégalités de revenus, y compris pour les personnes d’origine étrangère. Ils sont également plus favorables aux politiques « mondialistes » telles que l’aide internationale, la mondialisation et la prévention du dérèglement climatique. Les individus particularistes, qui privilégient la loyauté envers leur endogroupe, s’opposent souvent à ces politiques, craignant que la redistribution ne profite à des exogroupes ou à des étrangers au détriment de leur propre communauté, ou que l’immigration ne sape les chances de leurs voisins de trouver un emploi. Ce clivage moral contribue à la polarisation politique et complique les efforts pour parvenir à un consensus sur les politiques économiques.
L’une de mes études sur les tendances de vote aux États-Unis montre que les valeurs morales des électeurs s’alignent étroitement sur la rhétorique et la politique des différents candidats à l’élection. Ce lien apparaît encore plus fort à l’examen des données récentes que j’ai recueillies en collaboration avec Raymond Fisman, Luis Mota Freitas et Steven Sun. Nous quantifions l’universalisme moral à l’aide de statistiques à grande échelle sur les dons. Dans notre démarche, les districts américains sont considérés comme plus universalistes lorsque la part de leurs dons qui va à des bénéficiaires plus éloignés, géographiquement ou socialement, est plus importante. Les universalistes ne sont donc pas plus ou moins prosociaux — au contraire, les districts universalistes donnent plus à des endroits éloignés, mais moins à des causes communautaires locales.
Nous démontrons que les districts où l’universalisme est plus élevé ont tendance à voter davantage pour des candidats démocrates et à élire des représentants qui utilisent un langage moral universaliste dans leurs discours. En outre, les représentants de ces circonscriptions ont un comportement de vote par appel nominal plus à gauche, y compris au sein du même parti, ce qui montre une fois de plus que ces valeurs morales influencent à la fois les résultats électoraux et les actions législatives.
Approche interdisciplinaire
Les économistes sont traditionnellement prudents lorsqu’il s’agit d’aborder des questions morales, préférant s’en tenir à une analyse empirique, fondée sur des données. Cependant, je pense que les économistes ont tout à gagner à s’intéresser plus profondément à la psychologie morale, tout comme les psychologues peuvent bénéficier de l’incorporation de notions d’économie dans leur travail. Chaque discipline apporte des atouts uniques dans la corbeille : les économistes excellent dans la gestion et l’analyse de données à grande échelle, tandis que les psychologues moraux sont aptes à comprendre les processus complexes de la prise de décision individuelle et du raisonnement moral.
Cette approche interdisciplinaire peut conduire à une compréhension plus riche et plus nuancée de phénomènes sociaux et politiques complexes. Prenons, par exemple, la question de la redistribution. La recherche psychologique peut nous éclairer sur les raisons pour lesquelles les gens ont certaines convictions morales en matière d’équité et d’égalité ; les données économiques peuvent révéler comment ces convictions se traduisent dans les habitudes de vote et les préférences politiques. Combiner ces approches nous permet de dresser un tableau plus complet de la manière dont les valeurs morales influencent le comportement et les résultats économiques.
Qu’est-ce que tout cela signifie pour les décideurs ? Avant tout, cela tend à montrer qu’une politique économique efficace ne peut ignorer les considérations morales. Les responsables des politiques doivent reconnaître que les préférences économiques des individus sont souvent influencées par leurs convictions morales, lesquelles peuvent varier considérablement d’un groupe à l’autre. Par conséquent, les politiques qui se calquent sur les valeurs morales d’un groupe peuvent se heurter à la forte opposition d’un autre groupe dont les valeurs sont différentes.
Comprendre ces divisions morales peut aider les décideurs à élaborer des politiques plus efficaces et plus équitables. Par exemple, les politiques de redistribution qui font appel à des valeurs universalistes peuvent gagner en efficacité si elles sont formulées de manière à trouver un écho auprès des individus particularistes, en mettant notamment l’accent sur les avantages pour la collectivité locale.
En outre, la reconnaissance du rôle de la morale dans le comportement économique peut aider les pouvoirs publics à anticiper la polarisation politique et à y remédier. Cela pourrait s’avérer vital pour réduire les fractures morales qui nous éloignent du consensus.
Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.
BIBLIOGRAPHIE :
Enke, Benjamin. 2019. “Kinship, Cooperation, and the Evolution of Moral Systems.” Quarterly Journal of Economics 134 (2): 953–1019.
Enke, Benjamin. 2020. “Moral Values and Voting.” Journal of Political Economy 128 (10): 3679–729.
Enke, Benjamin. 2023. “Market Exposure and Human Morality.” Nature Human Behaviour 7: 134–41.
Enke, Benjamin. 2024. “Moral Boundaries.” Annual Review of Economics 16: 133–57.
Enke, Benjamin, Raymond Fisman, Luis Mota Freitas, and Steven Sun. 2024. “Universalism and Political Representation: Evidence from the Field.” American Economic Review: Insights 6 (2): 214–29.